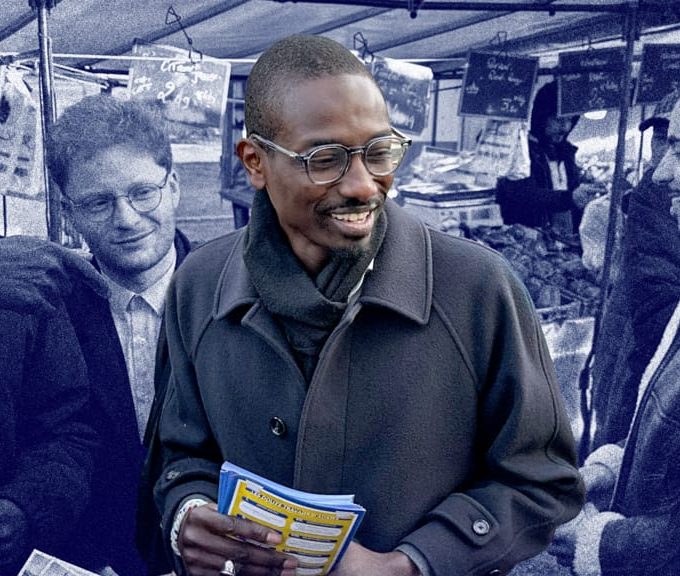Indépendante en 1974 après une guerre acharnée contre le Portugal, la Guinée-Bissau est l’un des rares États africains dont la naissance a été portée par un mouvement de libération armé : le PAIGC (Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert). Sa figure emblématique, Amílcar Cabral, assassiné en 1973, est restée un symbole fort. Mais dès l’indépendance, le rêve d’un État stable s’effrite.
Depuis 1974, la Guinée-Bissau connaît une succession de renversements de régime, mutineries et transitions avortées.
Parmi les épisodes les plus marquants :
le coup d’État de 1980 d’où émerge João Bernardo “Nino” Vieira ;
la guerre civile de 1998–1999, qui renverse Vieira ;
l’assassinat du président João Bernardo Vieira en 2009 ;
plusieurs putschs ou tentatives en 2003, 2010, 2012…
L’armée, fracturée en clans, est devenue au fil des décennies un acteur politique à part entière, souvent plus influent que les institutions civiles.
Une démocratie sous tension permanente
Officiellement multipartite depuis les années 1990, la Guinée-Bissau n’a jamais vraiment stabilisé son système démocratique.
Les élections y sont régulièrement :
contestées, entachées de suspicions,
ou suivies de conflits entre président, gouvernement et armée.Les coalitions se font et se défont, les dissolutions du Parlement sont fréquentes, et les crises institutionnelles s’enchaînent sur fond de rivalités personnelles.
Un président controversé : Umaro Sissoco Embaló
Arrivé au pouvoir en 2020, Umaro Sissoco Embaló, militaire de formation, s’est imposé comme une figure atypique : autoritaire, imprévisible, très présent sur la scène internationale, mais en conflit permanent avec l’opposition et une partie de l’armée.
Son mandat a été marqué par :
plusieurs dissolutions du Parlement,
des affrontements internes au sein des forces armées,
une tentative de coup d’État contre lui en 2022,
et une fragile cohabitation avec les partis traditionnels du pays.
Un pays stratégique, mais fragilisé par l’économie
La Guinée-Bissau est l’un des pays les plus pauvres au monde.
Son économie repose essentiellement sur :
l’anacarde (noix de cajou),
une pêche sous-exploitée,
et des ressources naturelles limitées.
Cette fragilité alimente la dépendance vis-à-vis des bailleurs internationaux.
Une plaque tournante du trafic de drogue
Depuis le début des années 2000, le pays est devenu une route privilégiée pour la cocaïne sud-américaine à destination de l’Europe. Des officiers, des personnalités politiques et même des proches du pouvoir ont été cités dans des scandales liés au narcotrafic. Cette réputation a valu à la Guinée-Bissau le surnom de “narco-État” dans certains rapports internationaux